- Accueil
- Publications et statistiques
- Publications
- Niveau de vie et risque de stagnation sé...
Billet n°1. La progression du niveau de vie moyen s’affaiblit continûment sur les dernières décennies dans toutes les économies les plus développées. Cet essoufflement, qui renvoie à celui de la productivité, nourrit la crainte d’avoir amorcé une période de stagnation séculaire. En fait, un potentiel de rattrapage important existe dans de nombreux pays, notamment en Europe, mais sa concrétisation nécessite la mise en œuvre déterminée de réformes structurelles.
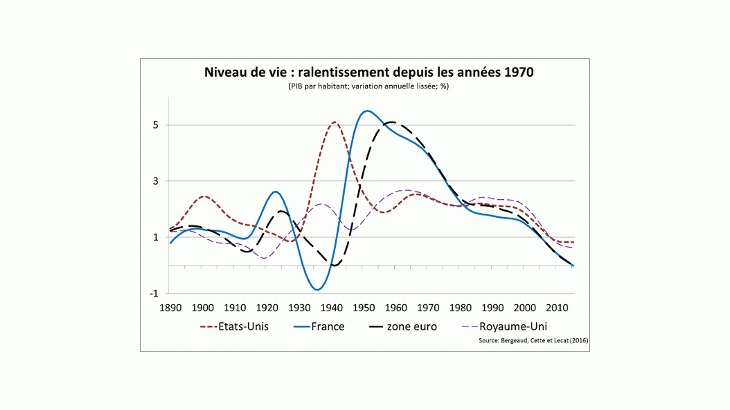
Graphique : afin de capter les cycles d’un quart de siècle ou plus, les courbes décrivent la tendance du taux de croissance du ratio PIB par habitant obtenue par la méthode Hodrick-Prescott. La Zone euro est reconstituée à partir de l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal et la Finlande. Les données sont disponibles sur le site www.longtermproductivity.com.
Le PIB par habitant : un bon indicateur du niveau de vie économique
Le niveau de vie économique est souvent mesuré par le PIB par habitant. Ce dernier ralentit continûment sur les dernières décennies dans les pays développés. Ainsi, le taux de croissance annuel du PIB par habitant a été de 0,6% aux États-Unis sur les dix dernières années (2005-2015) contre 2,2% au XXe siècle et en France de 0,3% contre 2,1% (voir le Graphique repris de "Rue de la Banque" # 11).
Une grande vague de croissance au cours du XXème siècle
Pour chaque pays ou ensemble économique, on observe une forte et longue vague de croissance du PIB par habitant au cours du XXe siècle. Celle-ci n’est pas la même dans toutes les régions : à partir des années 1930 et jusqu’aux années 1950, elle concerne les États-Unis ; puis, de l’après-guerre jusqu’aux années 1960, la zone euro (reconstituée à partir de l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal et la Finlande), dont la France et, de façon moins marquée, le Royaume-Uni. L’ampleur de cette vague est également très différente selon les économies, les pays partant du niveau de PIB par habitant le plus élevé, ici le Royaume-Uni, ayant la croissance la plus faible.
Cette vague correspond notamment à la diffusion des innovations issues de la 2nde révolution industrielle, qui a soutenu la croissance de la productivité et donc du niveau de vie économique moyen. Ces innovations couvrent un très large spectre : chimie, pharmacie, énergie (pétrole et électricité), le transport et la génération de puissance industrielle (moteur électrique, moteur à explosion) ou encore les télécommunications (téléphone, radio ou cinéma). Cette vague est également liée à des innovations dans le processus de production (Taylorisme) ou encore les modes de financement (Bergeaud, Cette et Lecat, 2016). Les autres pays avancés ont bénéficié d’un processus de rattrapage après-guerre grâce à la libéralisation des échanges, au progrès de l’éducation et à des institutions économiques mieux adaptées.
Un ralentissement par palier depuis les années 1970
Depuis les années 1970, dans les pays avancés étudiés, le PIB par habitant ralentit par palier, avec une courte interruption induite par la révolution des technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce nouveau cycle est d’ampleur plus limitée, avec un pic de croissance du PIB par habitant à un peu plus de 2% aux États-Unis au tournant des années 2000 (le PIB ayant crû plus du fait de la démographie). Il est plus court, avec un ralentissement dès le milieu des années 2000, avant la crise financière. Enfin, tous les pays n’en bénéficient pas. Clairement, l’Europe n’a pas connu d’accélération de son PIB par habitant.
Cette nouvelle donne a des conséquences importantes pour les pays et les populations concernés. Par exemple, la croissance du PIB par habitant a facilité la soutenabilité de nombreuses dépenses sociales dont les retraites, mais aussi des dépenses publiques et plus généralement la capacité à améliorer le bien-être matériel. Est-il envisageable de bénéficier à nouveau des rythmes de croissance observés au XXe siècle ?
Pas de rattrapage sans réformes ambitieuses
Le nouveau ralentissement de la croissance depuis le milieu des années 2000 fait craindre aujourd’hui une ère de "stagnation séculaire", c’est-à-dire une situation durable de très faible croissance. Les techno-pessimistes (Robert Gordon, notamment) considèrent en effet que la grande vague du XXe siècle est un épisode isolé dans l’histoire de l’humanité qui serait lié à une série exceptionnelle d’innovations simultanées dans de nombreux domaines. Le ralentissement de la productivité avant même la crise financière, largement expliqué par la moindre contribution des technologies de l’information et de la communication (TIC), conforte cette hypothèse.

En revanche, selon, les techno-optimistes (J. Mokyr, E. Brynjolfsson et A. McAfee, notamment), les TIC ont un potentiel exponentiel d’innovations et contribueront à une nouvelle vague de croissance de la productivité. Cette position est confortée par l’absence de ralentissement de la productivité des entreprises les plus productives. Le ralentissement de la productivité moyenne résulterait dans ce cas d’une divergence croissante entre ces entreprises et les autres (Andrews, Criscuolo et Gal, 2015). Les raisons de cette divergence font l’objet d’analyses et ne sont pas consensuelles, les travaux conduits à la Banque de France montrant que les innovations technologiques ne constituent qu’une part de l’explication des grandes vagues de productivité observées au XXème siècle.
Toutefois, il reste un potentiel très important de rattrapage pour les pays où la diffusion des TIC a été plus limitée qu’aux États-Unis. C’est le cas de la France et plus généralement de la zone euro. Au niveau microéconomique, une meilleure allocation des compétences et des capitaux entre entreprises ou encore des progrès dans les techniques de management constituent également un réservoir de croissance substantiel.
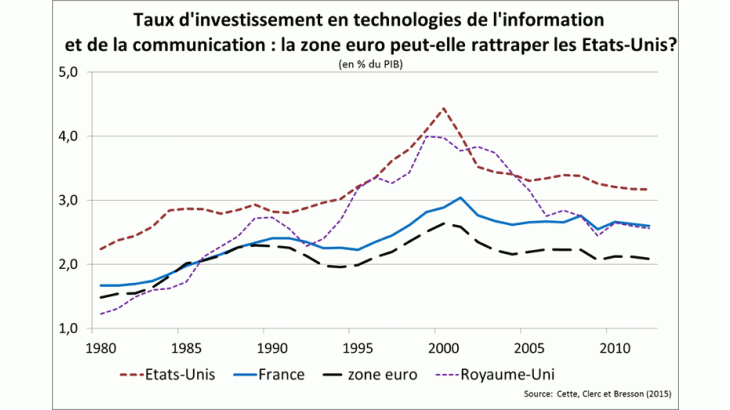
La réalisation de ce potentiel de rattrapage suppose la mise en œuvre de réformes structurelles ambitieuses : des incitations au changement, en favorisant notamment la libre entrée sur le marché des produits ; des possibilités d’adaptation du processus de production, par une flexibilité suffisante du marché du travail, par une formation professionnelle développant des compétences appropriées aux besoins et par un accès à des financements adaptés pour les entreprises les plus prometteuses.
Quelques Références :
Andrews, D., C. Criscuolo and P. Gal (2015): “Frontier Firms, Technology Diffusion and Public Policy: Micro Evidence from OECD Countries”, OECD Global Productivity Forum background paper.
Bergeaud, A., G. Cette et R. Lecat (2016): "Productivity trends from 1890 to 2012 in advanced countries," the Review of Income and Wealth, vol. 62, issue 3, pp. 420-444.
Cette, G., C. Clerc et L. Bresson (2015): “Contribution of ICT Diffusion to Labour Productivity Growth: The United States, Canada, the Eurozone, and the United Kingdom, 1970-2013”, International productivity monitor, n°28, Spring.
Les données sont disponibles sur le site www.longtermproductivity.com.
Mise à jour le 25 Juillet 2024