- Accueil
- Publications et statistiques
- Publications
- La crise de 1929
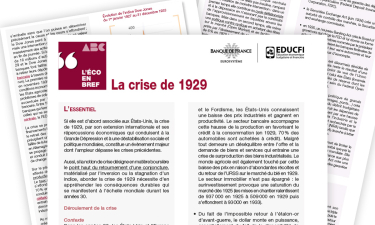
La crise de 1929, considérée comme la première crise systémique de l’histoire, débute par une crise financière aux États-Unis, qui entraine la Grande Dépression puis se propage au monde entier. Elle reste aujourd’hui invoquée comme une référence dans la compréhension des crises récentes tant pour ses mécanismes que pour les actions qu’elle implique de la part du pouvoir politique et des banques centrales. Découvrez dans cette fiche pédagogique de 4 pages et 4 infographies son déroulement, les mesures mises en œuvre pour y répondre ainsi que la perception et les leçons qui en ont été tirées.
Si elle est d’abord associée aux États-Unis, la crise de 1929, par son extension internationale et ses répercussions économiques qui conduisent à la Grande Dépression et à une déstabilisation sociale et politique mondiales, constitue un évènement majeur dont l’ampleur dépasse les crises précédentes.
Aussi, si la notion de crise désigne en matière boursière le point haut du retournement d’une conjoncture, matérialisé par l’inversion ou la stagnation d’un indice, aborder la crise de 1929 nécessite d’en appréhender les conséquences durables qui se manifestent à l’échelle mondiale durant les années 30.
Déroulement de la crise
Contexte
Dans les années 20, les États-Unis et l’Europe semblent caractérisés par une prospérité économique durable et le monde engagé dans une paix stable favorable au développement économique. Entre 1926 et 1929, la production industrielle mondiale et le commerce international ont connu une hausse de 15 %. À l’été 1929, le début de récession qui touche l’Allemagne, le Canada et le Brésil inquiète peu.
Sur le plan financier, l’indice du cours des actions à la bourse de Wall Street augmente considérablement, bien plus que la hausse des profits sur la même période : en 10 ans, les cours sont multipliés par 3 avec une hausse moyenne de 12 % par an. L’économiste américain Irving Fisher déclare début octobre 1929 que le cours des actions a « atteint un plateau haut permanent ». On assiste à une euphorie spéculative qui entraine une partie importante de la population dans des opérations boursières.
Causes
Dans ce contexte, la survenue du krach boursier les 24 et 29 octobre 1929 (Jeudi noir et mardi noir/ Black Thursday et Tuesday), interroge et implique d’analyser les causes structurelles qui ont pu y conduire.
Deux éléments semblent déterminants :
- En fondant leur développement économique sur la production de masse permise par le Taylorisme et le Fordisme, les États-Unis connaissent une baisse des prix industriels et gagnent en productivité. Le secteur bancaire accompagne cette hausse de la production en favorisant le crédit à la consommation (en 1929, 70 % des automobiles sont achetées à crédit). Malgré tout demeure un déséquilibre entre l’offre et la demande de biens et services qui entraine une crise de surproduction des biens industrialisés. Le monde agricole est également touché par cette baisse des prix en raison d’abondantes récoltes et du retour de l’URSS sur le marché du blé en 1929. Le secteur immobilier n’est pas épargné : le surinvestissement provoque une saturation du marché dès 1925 (les mises en chantier ralentissent de 937 000 en 1925 à 509 000 en 1929 puis s’effondrent à 93 000 en 1933).
- Du fait de l’impossible retour à l’étalon-or d’avant-guerre, le dollar monte en puissance, essentiellement du fait de la disponibilité de fonds à prêter en dollars. Malgré l’adoption du Gold exchange standard en 1922, la concurrence monétaire entre États est forte, générant de l’instabilité qui aboutit à la création de zones monétaires (Bloc Sterling, Bloc or autour du franc français, zone dollar). Cette fragmentation entraine un ralentissement du commerce à l’échelle mondiale.
Manifestations
Le krach boursier apparait comme le révélateur de cette situation instable ; son ampleur financière et géographique dépasse toutes les crises précédentes du fait de ces conditions structurelles et de la diffusion en Europe de capitaux américains qui imbriquent les économies des deux continents.
Elle se déroule selon un schéma désormais considéré comme classique :
La spéculation est facilitée par la pratique de l’achat à crédit qui alimente la bulle spéculative : aux États‑Unis, l’achat d’actions par emprunt atteint jusqu’à 90 % remboursés par plus-values lors de la vente de l’action. S’il y a moins-value, le courtier doit vendre les actifs en réserve à défaut de versement de nouveaux fonds par le propriétaire des titres, ce qui entraine une baisse des cours en cas de ventes massives.
En l’espèce, la crise financière reste essentiellement américaine : le jeudi 24 octobre, la vente d’actions s’emballe sans que l’on puisse en déterminer précisément la cause et les cours s’effondrent ; le Dow Jones perd à midi 22,6 % de sa valeur mais une intervention des banques qui rachètent massivement des actions ramène la baisse à 2,1 % en fin de journée. Si les cours se stabilisent, près de 16 millions d’actions sont vendues le mardi 29 et le Dow Jones perd à nouveau 12 %. Les banques font faillite et les particuliers cherchent à retirer leurs dépôts ce qui provoquent une crise bancaire à travers des ruées sur les guichets (bank run). La première vague de faillites bancaires a lieu en novembre 1930 mais est fortement liée aux conditions économiques locales, en particulier dans les États agricoles, car la clientèle rencontre des problèmes de solvabilité du fait de la surproduction, accentuée par l’insuffisance de la régulation bancaire. Entre 1929 et 1933, ce sont près de 9000 banques qui ferment définitivement, essentiellement celles qui ne sont pas supervisées par la banque centrale, la FED.
La crise se propage en Europe avec l’arrêt des financements levés sur le marché de New York puis le retrait des capitaux américains. Ces décisions précipitent une crise bancaire en Autriche avec la faillite de la banque Kreditanstalt le 11 mai 1931 puis en Allemagne avec la banque Danat le 13 juillet. Elle se propage ensuite en Angleterre au cours de l’été et conduit à la sortie de la Livre sterling de l’étalon de change or et à sa dévaluation.
Sur le plan économique, la dépression qui suit affecte de nombreux pays. En 1932 l’indice de production mondial est 35 % plus faible qu’en 1929. Le taux d’investissement des pays industrialisés s’effondre (de 15 % du PIB mondial en 1929 à 10 % en 1932). Les prix chutent drastiquement, conduisant la plupart des pays à des politiques de déflation. Les faillites s’enchainent dans l’industrie, entrainant une explosion du chômage (en 1928 on dénombre 6 millions de chômeurs dans les pays industrialisés contre 35 millions en 1932).
Au niveau international, la réaction protectionniste crée une contraction du commerce international et amplifie la spirale déflationniste. La perte de confiance des consommateurs restreint les achats non essentiels ou les investissements de long terme, entrainant une baisse de l’activité de production des entreprises et une hausse du chômage. Ainsi, les ventes de voitures neuves aux États-Unis chutent passant de 2 500 000 exemplaires en 1930 à 1 500 000 en 1932 entrainant faillites et hausse du chômage.
Quelques chiffres
16
Nombre d’actions vendues dans la seule journée du mardi 29 octobre 1929 (en millions)
35
Nombre de chômeurs dans les pays industrialisés en 1935 (en millions)
- 30 %
Chute de la production industrielle américaine entre 1929 et 1932
- 40 %
Effondrement des cours boursiers aux États-Unis lors du dernier trimestre de 1929
- 72 %
Effondrement de la valeur des exportations mondiales entre 1929 et 1932
Télécharger l'intégralité de la publication
Découvrir
L'Éco en Bref
En savoir plusMot de l'actu
En savoir plusVidéos
En savoir plusJeux
En savoir plusAteliers
En savoir plusConcours
En savoir plusL'Éco en Bref
Outils statistique
Mot de l'actu
Outils statistique
Vidéos
Outils statistique
Jeux
Outils statistique
Ateliers
Outils statistique
Concours
Outils statistique
Mise à jour le 17 Novembre 2025