- Home
- Publications et statistiques
- Publications
- Interdépendances entre la politique moné...
Interdépendances entre la politique monétaire et la politique budgétaire
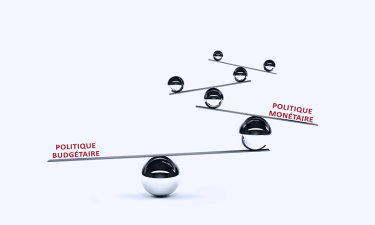
L’essentiel
Politique budgétaire et politique monétaire sont deux politiques dites macroéconomiques et conjoncturelles. Elles sont menées par des acteurs différents qui sont indépendants l’un de l’autre. Cette indépendance ne signifie pas pour autant que ces politiques ne sont pas interdépendantes. En effet, toutes deux agissent sur l’économie et leurs interdépendances se manifestent dans leurs effets réciproques ou les contraintes que l’une peut exercer sur l’autre.
La politique est macroéconomique car elle influence les variables agrégées (consommation des ménages, investissement des entreprises, PIB, emploi, etc.). Elle est conjoncturelle car elle agit à court terme. Dans la terminologie de Richard Musgrave, les politiques macroéconomiques conjoncturelles ont, entre autres, une fonction de régulation (stabilisation) de la conjoncture.
Les instruments des politiques macroéconomiques conjoncturelles sont de nature diverse (fiscalité, dépenses publiques, taux d’intérêt, etc.) et leurs effets se diffusent via les composantes de la demande globale, également appelée demande agrégée (consommation des ménages, investissement des entreprises, exportations nettes des importations).
La politique budgétaire, menée par le gouvernement, désigne l’ensemble des actions visant à agir sur la situation macroéconomique en utilisant le budget des administrations publiques. Celui-ci comprend les recettes publiques qui sont composées pour l’essentiel des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales), et les dépenses publiques qui correspondent aux dépenses de fonctionnement, sociales et d’investissement. Les recettes publiques et les nouveaux emprunts publics permettent de financer les dépenses publiques. L’impact du solde budgétaire englobe deux types d’actions : la stabilisation automatique et la politique discrétionnaire.
• La stabilisation automatique décrit la réaction spontanée et stabilisante du budget des administrations publiques, suite à une hausse ou baisse de la demande. Quand la croissance est faible ou négative, les dépenses publiques augmentent spontanément (indemnisation du chômage notamment) et les recettes de l’État diminuent. Cela a un effet automatiquement positif sur la consommation et l’investissement en redonnant du pouvoir d’achat aux ménages et aux entreprises. Inversement, quand la croissance accélère, l’effet est opposé. Les dépenses publiques baissent (moindre indemnisation du chômage) et les recettes publiques augmentent. Cela a un effet automatiquement négatif sur la consommation et l’investissement en réduisant le pouvoir d’achat des agents économiques.
• La politique discrétionnaire exprime la volonté délibérée de modifier les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires (par exemple en modifiant le taux d’impôt sur le revenu pour les ménages et le taux d’impôt sur les sociétés pour les entreprises) afin d’influencer la demande globale, l’activité, l’emploi, le chômage.
La politique monétaire, menée par la banque centrale, a pour principal objectif le maintien de la stabilité des prix (définie par la BCE par un taux d’inflation autour de 2% par an sur le moyen terme, ce qui concourt à la croissance de l’économie). Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques de l’Union. L’action de la banque centrale consiste à contrôler la quantité de monnaie en circulation et son prix. L’instrument principal de la politique monétaire est le taux d’intérêt directeur (taux principal des opérations de refinancement des banques). Les variations du taux d’intérêt directeur se transmettent aux taux du marché monétaire (au jour le jour) et aux taux d’intérêt que les banques appliqueront lors de leurs opérations de crédit aux entreprises et aux ménages. Ses effets transitent aussi par les marchés financiers et le canal des anticipations d’inflation des agents économiques.
La politique budgétaire et la politique monétaire :
• sont décidées et mises en œuvre par des autorités institutionnelles différentes : États pour la politique budgétaire, et banque centrale pour la politique monétaire. Dans la zone euro, la politique monétaire est unique, mais les politiques budgétaires sont nationales et encadrées par des règles budgétaires européennes. La politique monétaire est indépendante, c’est-à-dire que ni la BCE ni les banques centrales nationales ne peuvent solliciter ni accepter des instructions venant des institutions de l’Union européenne ou des gouvernements. En outre, le financement monétaire (monétisation) des États est strictement interdit. …/… Interdépendances entre la politique monétaire et la politique budgétaire Ressource pédagogique créée avec la contribution de David Mourey, professeur de Sciences Économiques et Sociales Juin 2024 Retrouvez-nous sur le site internet de la Banque de France, rubrique ABC de l’économie 2
• influencent les décisions des agents économiques (consommation, investissement, crédit, etc.) par différents canaux (fiscalité, dépenses publiques, taux d’intérêt, endettement à crédit).
• peuvent s’influencer mutuellement : la politique monétaire modifie les conditions financières : les coûts d’emprunt de l’État, plus indirectement la demande globale et les prix, mais aussi les recettes et les dépenses de l’État. La politique budgétaire influence indirectement le niveau des prix à la fois par ses effets sur la demande agrégée et sur l’offre agrégée (impact sur les capacités de production).
• peuvent avoir deux types d’orientations : expansionniste ou restrictive (voir Comprendre).
Le « policy mix » fait référence à la combinaison des politiques budgétaire et monétaire. Il permet d’aborder les interdépendances dans leurs effets sur l’activité qui peuvent se cumuler (combinaisons convergentes) ou se neutraliser (combinaisons divergentes) ainsi que les interdépendances dans les contraintes qu’une politique peut faire peser sur les marges de manœuvre de l’autre.
Chacune des deux politiques doit rester crédible pour optimiser l’efficacité de l’autre. Ainsi, une politique budgétaire assurant une évolution « soutenable » de l’endettement public permet d’éviter le risque de dominance budgétaire, qui se traduit par une politique monétaire excessivement expansionniste, source potentielle d’inflation. Autre illustration : une politique monétaire adaptée et équilibrée contribue à limiter la hausse des taux d’intérêt et donc le coût de la dette publique.
Les crises récentes traversées par la zone euro (crise de 2008, crise des dettes souveraines de la zone euro, crise sanitaire) ont mis en lumière une dépendance réciproque accrue entre les politiques budgétaire et monétaire. En effet, pour surmonter les difficultés et être plus efficaces, ces politiques doivent être mutuellement cohérentes.
Télécharger l'intégralité de la publication
Updated on the 16th of October 2025